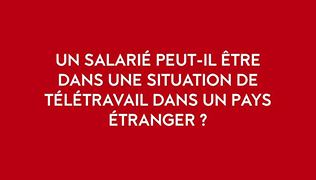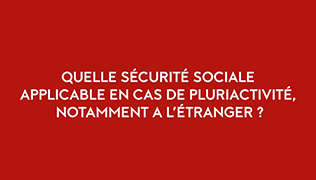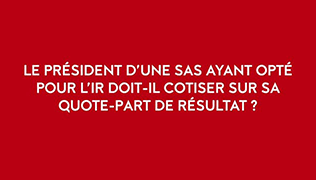Une question ?
L’appel expert vous répond
Un salarié peut-il être dans une situation de télétravail dans un pays étranger ?
Aucun texte n’interdit qu’un salarié dont l’employeur est situé en France travaille dans un pays étranger à son domicile. Le lieu d’exécution du contrat de travail retenu est alors le pays d’accueil, et non la France.
L’employeur et le salarié peuvent choisir la loi qu’ils souhaitent appliquer au contrat de travail (Règlement CE 593/2008). Cependant, les règles d’ordre public du pays d’accueil doivent être respectées (ex : durée du travail, salaire minimum, règles relatives à la santé et la sécurité des travailleurs, etc.).
En matière de sécurité sociale, par défaut, le salarié en télétravail à l’étranger est dans une situation d’expatriation. Exerçant son activité dans un pays étranger, il est soumis au régime de sécurité sociale de ce pays, où doivent être réglées les cotisations sociales (Règlement CE 883/2004, art. 11).
Dans le cadre de l’Union Européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse, le salarié peut, sur option de l’employeur, être détaché au sens de la sécurité sociale pour une durée initiale de 24 mois. Le salarié continue alors à être affilié au régime de sécurité sociale de son pays d’envoi, la France, sans cotiser dans son pays d’accueil (Règlement CE 883/2004, art. 12). Hors de ce cadre, des conventions bilatérales prévoient également la possibilité de détacher des salariés.
La fusion met-elle fin à l’amortissement des frais d’acquisition des titres de la société absorbée ?
Lorsqu’une société acquiert des titres de participation, les frais d’acquisition de ces titres (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes) sont en principe incorporés au coût d’acquisition et donc amortis. Le Plan comptable général (article 221-1 renvoyant à l'article 213-8) offre cependant la possibilité à la société de comptabiliser ces frais en charges. L’administration fiscale s’oppose néanmoins à ce que cette charge soit immédiatement déductible en prévoyant sa réintégration au bénéfice imposable l’année d’acquisition des titres puis sa déduction extra-comptable étalée sur cinq ans (BOI-IS-BASE-30-10 n° 120 et n°170). Il s’agit donc d’un amortissement purement fiscal.
En cas de fusion (ou de TUP), se pose alors la question de savoir ce qu’il advient de cet étalement quand l’opération a lieu moins de cinq ans après l’acquisition des titres. L’administration fiscale considère dans ce cas que, quelle que soit l’option comptable retenue, les titres de la société absorbée étant annulés du fait de la fusion, les frais d'acquisition portant sur ces titres ne peuvent plus être amortis à compter sa date. Ceci est la conséquence de la prise en compte de la fraction d’amortissement non déduite des frais d’acquisition, dans le prix de revient fiscal des titres servant au calcul du boni ou du mali de fusion (BOI-IS-BASE-30-10 n° 310 et 320).
L'adoption à une majorité erronée d’une décision d’AG de copropriété, quel délai pour contester ?
De nombreuses décisions sont soumises au vote de l’assemblée générale des copropriétaires à des conditions de majorité diverses prévues par la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Une décision qui aurait été prise à une majorité erronée a bel et bien « le caractère d’une véritable décision » (Cass. 3ème civ. 2 février 1994, n°91-12.676). Un copropriétaire ne saurait invoquer une absence de décision.
La contestation doit être introduite, à peine de déchéance, par le copropriétaire opposant ou défaillant dans un délai de deux mois à compter de sa notification (article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965). A défaut, la décision devient incontestable (Cass. 3ème civ. 18 novembre 2008, n°07-18.823).
Ce délai de deux mois est un délai préfix, et non un délai de prescription (Cass. 3ème civ. 4 juin 2003, n°02-11.134), et s’applique de façon générale à tous les types d’illégalités ou d’irrégularités de l’assemblée des copropriétaires (Cass. 3ème civ. 18 novembre 2008 précité).
En l’absence de notification ou si celle-ci est irrégulière, les copropriétaires peuvent contester la décision pendant cinq ans (article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précité).
Enfin, si un copropriétaire laisse s’écouler ce délai de deux mois, il pourra le cas échéant envisager d’engager la responsabilité quasi délictuelle du syndicat des copropriétaires (Cour d’appel de Versailles, 12ème cbre section 2. 17 novembre 2005, n°04/04595) ou la responsabilité délictuelle du syndic, sauf à ce que ce dernier justifie d’un doute légitime quant à la majorité requise, notamment en cas de silence de la loi (Cour d’appel de Paris, 23ème cbre B. 5 mars 2009, n°08/05968).
Le salarié qui démissionne pour suivre son conjoint à l’étranger peut-il bénéficier du chômage ?
Le droit à l’indemnisation chômage est en principe conditionné par la perte involontaire de son contrat de travail.
Toutefois, certaines démissions, qualifiées de légitimes, ouvrent également droit à l’assurance chômage. Tel est le cas de la démission pour suivre son conjoint qui change de domicile afin d’exercer un nouvel emploi.
Se pose alors la question de l’indemnisation chômage du bénéficiaire quand celui-ci suit son conjoint à l’étranger ?
En effet, ne peut prétendre à l’allocation chômage le demandeur d’emploi que s’il réside sur le territoire français (art. 4 du Règlement chômage du 26 juillet 2019).
Selon le Pôle emploi, deux situations sont envisagées :
- Si vous partez dans un Etat européen (UE, EEE, Royaume-Uni ou Suisse), vous pouvez prétendre au maintien de l’allocation chômage durant 3 mois maximum si, avant votre départ, vous êtes inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi en France et que vous avez ouvert des droits. Cette période pouvant être éventuellement prolongée jusqu'à 6 mois (au libre choix des Etats membres).Pour pouvoir en bénéficier, Pôle emploi délivre un formulaire « U2 - Maintien de droit aux prestations de chômage ». Ce document est destiné à la personne qui se trouve au chômage sur le territoire d'un État membre et qui se rend sur le territoire d'un autre État membre afin d'y chercher un emploi. »
- La démission pour suivre le conjoint étant légitime, le demandeur d’emploi pourra prétendre à l’allocation chômage à son retour en France.
Attention, toutefois, car ce droit est conditionné par une inscription au Pôle emploi dans un délai de 4 ans maximum suivant la date de démission (art. 7 du Règlement chômage du 26 juillet 2019).
Doit-on décompter du forfait jours le temps passé à un trajet de mission ?
Le salarié en forfait jours dispose d’un nombre de jours de travail sans qu’un nombre d’heures ne soit fixé.
Ainsi, « toute journée comportant pour partie du temps de travail, même dans des proportions très faibles, doit être comptabilisée comme un jour travaillé, sauf à identifier la prise effective d'une demi-journée de repos (Rapport AN n° 1826 p. 169) ».
En effet, selon le Ministère du travail, le forfait en jours repose sur l'abandon d'une logique de décompte des heures de travail effectif.
Dès lors, peu important le nombre d’heures travaillées dans la journée, il sera comptabilisé une journée ou, si l’accord le prévoit, une demi-journée à condition que l’intervention ne dépasse pas cette durée (Circulaire 2000-07 du 6/12/2000).
Lorsque pour se rendre à un lieu de travail, le salarié en forfait jours réalise un long trajet en voiture qui couvre tout ou partie d’une journée non travaillée (un dimanche par exemple), doit-on le décompter du forfait jours ?
A notre sens non, en application des éléments ci-dessus évoqués, car le salarié n’a pas exécuté, y compris dans de faibles proportions, son travail sur cette journée.
Quelle fiscalité pour la prise en charge par la société des cotisations sociales sur dividendes ?
Les cotisations sociales obligatoires des travailleurs non salariés sont des dettes personnelles dont le paiement incombe aux travailleurs indépendants. Il en est ainsi de la part des revenus distribués supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission ainsi que des sommes versées en compte courant perçue par le gérant associé majoritaire d’une SARL. (art. L. 131-6 du code la sécurité de la sécurité sociale).
Toutefois, la société peut acquitter ces cotisations sociales en lieu et place du dirigeant dans la mesure où leur prise en charge est prévue, pour les gérants de SARL, par les statuts ou a été approuvée par l'assemblée générale.
Dans ces conditions, les cotisations sociales prises en charge par la société au nom du dirigeant présentent le caractère d'un supplément de rémunérations et sont déductibles du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés sur le fondement de l'article 211 du CGI. Corrélativement, cette somme, qui constitue un avantage, est imposable à l'impôt sur le revenu au nom du dirigeant dans les conditions de droit commun prévues à l'article 62 du CGI (Rép. min. Frassa JO Sénat question n° 12909 du 31 octobre 2019).
Peut-on mobiliser son CPF quand on prend sa retraite ?
Le compte personnel de formation (CPF) est ouvert à toute personne âgée de 16 ans. Il est alimenté à hauteur de 500 € chaque année, dans la limite d’un plafond total de 5 000 € (C. trav. Art. R. 6323-1).
La finalité de ce compte est de permettre à son bénéficiaire de se former tout au long de sa vie professionnelle.
Toutefois, le CPF cesse d’être alimenté et les droits qui y sont inscrits ne peuvent plus être mobilisés lorsque son titulaire se trouve dans l’une des situations suivantes (C. trav. Art. L 6323-3 et L 5421-4) :
• Il a fait valoir ses droits à la retraite à taux plein sans décote (personne ayant 62 ans pour la génération née à partir de 1955 et la durée d’assurance requise permettant départ à taux plein) ;
• Il a fait valoir ses droits à la retraite à taux plein dans le cadre d’un départ anticipé (carrières longues, handicap, …) ;
• Il a dépassé de 5 ans l’âge légal de départ à la retraite (à partir de 67 ans pour la génération née à partir de 1955).
Ainsi, dès lors que le titulaire du CPF bénéficie d’une retraite à taux plein, il ne peut plus mobiliser son CPF pour une formation, même s’il a repris une activité professionnelle dans le cadre d’un cumul emploi retraite.
En revanche, le titulaire du CPF qui s’inscrit dans le cadre d’un cumul emploi retraite mais avec un taux minoré de sa retraite, peut encore mobiliser ses droits CPF et acquérir de nouveaux droits.
Qui peut être destinataire des données de ressources humaines ?
Qui en dehors des collaborateurs des services des ressources humaines peut avoir accès à ces dites ressources ? Un service en charge des audits pourrait-il y en être destinataire ?
La CNIL, dans un référentiel portant sur le traitement des données à caractère personnel mis en œuvre aux fins de gestion du personnel, indique que seules les personnes habilitées au titre de leurs missions ou de leurs fonctions, peuvent accéder aux données à caractère personnel traitées, et ce, dans la stricte limite de leurs attributions respectives et de l’accomplissement de ces missions et fonctions. Il peut s’agir, par exemple des personnes habilitées chargées de la gestion du personnel ou de la gestion de la paie, ou des personnes habilitées chargées d’assurer la sécurité des personnes et des biens, pour les besoins du contrôle d’accès aux locaux et aux outils de travail, ou encore des supérieurs hiérarchiques des employés concernés, à l'exclusion des données relatives à l'action sociale directement mise en œuvre par l'employeur.
La CNIL précise qui peut être destinataire de ces informations. Parmi le public cité, on retrouve effectivement les entités chargées de l'audit et du contrôle financier de l'entreprise.
Occuper un bien immobilier héréditaire vaut-il acceptation tacite de la succession ?
L’article 782 du Code civil énonce que l’acceptation d’une succession peut être tacite dès lors où « le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant ».
La jurisprudence considère ainsi qu’occuper un bien successoral vaut acceptation tacite de la succession (Cass. Req. 8 novembre 1987, S. 1890. 1. 503) lorsque cette occupation n’existait pas antérieurement au décès (Cass. 1ère civ. 19 décembre 1979, n°78-15.049). La jurisprudence ajoute, concernant l’occupation d’un bien immobilier du défunt ayant débuté avant le décès de celui-ci, et qui se serait poursuivie ultérieurement, que l’héritier ne saurait être regardé comme acceptant la succession, en l’absence de tout acte d’immixtion ou intention nettement décevable chez lui d’accepter la succession (TGI de Beauvais. 26 novembre 1980).
Ainsi, la simple occupation ou utilisation d’un bien successoral ayant débuté avant le décès, mais s’étant poursuivie ultérieurement, ne constitue pas à elle seule, un cas d’acceptation tacite de la succession.
Tout au plus, l’occupant sera redevable, à l’égard de l’indivision successorale, d’une indemnité d’occupation jusqu’au jour du partage, et dont le montant sera porté à l’actif du compte de l’indivision (article 815-9 du Code civil).
En cas de transfert de contrat, y a-t-il proratisation du plafond de la sécurité sociale ?
Le code du travail instaure un principe de maintien des contrats de travail dans certains cas de modification de la situation juridique de l’entreprise (C. trav., art. L. 1224-1). Il arrive également que ce principe de maintien des contrats soit mis en œuvre de manière volontaire (dans le cas d’une perte de marché par exemple).
Dans une pareille situation et à compter de la date effective de la reprise, le repreneur va donc devoir assurer la rémunération de l’ensemble des salariés dont le contrat est maintenu. Ces salariés, bien qu’ayant bénéficié d’une reprise d’ancienneté, n’ont pas d’historique connu au sein du système de paie du nouvel employeur. Or, le transfert de contrats entre sociétés différentes ne peut être considéré comme une « nouvelle embauche » (dès lors que les salariés conservent leur ancienneté et ne perçoivent pas d’indemnité de licenciement). Ainsi, en cas de transfert, il convient de se placer dans la continuité du contrat (l’employeur ne fait que se substituer au précédent employeur).
En conséquence, il n’y a aucune justification permettant l’application d’un plafond réduit (Cass. soc. 3-5-1989 n° 86-15.021 P, Urssaf de Beauvais c/ SA Compiègne Oléagineux). Lors de la régularisation annuelle, le nouvel employeur doit donc procéder à la régularisation comme s’il avait été l’employeur des salariés transférés depuis le début de l’année.
Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est-il soumis au secret professionnel ?
L’’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs est réglementée par le Code de l’action sociale et des familles.Bien qu’aucun texte spécifique n’impose le secret à ce professionnel, il reste concerné par le principe général posé par l'article L. 1110-4, I du Code de la santé publique.
Ce texte prévoit que toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins, le service de santé des armées, un professionnel du secteur social ou médico-social (SMS) ou un établissement ou service social et médico-social (ESSMS) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations le concernant.
Il poursuit ainsi : « Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venue à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. » (Voir l’étude Secret professionnel du Dictionnaire permanent Action sociale aux Editions Législatives).
Dès lors, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui se voit confier la tutelle d’un usager d’un établissement et service social ou médico-social tel un service de soins infirmiers à domicile, sera soumis au secret professionnel.
Par ailleurs, l’échange et le partage d'informations médicales concernant cet usager sera possible entre les professionnels de santé et les professionnels du secteur social ou médico-social comme les mandataires judiciaires à la protection du majeur (R. 1110-2 du CSP).
Quelles sont les règles fiscales applicables aux donations internationales ?
Il est fréquent qu’une personne souhaite gratifier un proche qui réside à l’étranger ou qu’il souhaite donner un bien situé dans un autre État que son pays de résidence. Comment déterminer, dans ces cas, dans quel(s) pays les droits de donation seront dus ?
Quelles sont les règles internes de territorialité en matière de donations ?
Les droits de donation obéissent, en droit interne, aux mêmes règles de territorialité que celles applicables en matière de droits de succession. Elles sont prévues à l’article 750 ter du CGI et sont fonction de la résidence du donateur, du lieu de situation des biens et de la résidence du donataire.
Ainsi, une première dichotomie doit être établie selon le domicile fiscal du donateur.
Première hypothèse : lorsque le donateur réside fiscalement en France, tous les biens qu’il transmet sont soumis aux droits de donation français, qu’ils soient situés en France ou à l’étranger. L’éventuelle double imposition qui en résulterait est gommée par l’imputation de l’impôt étranger sur l’impôt français.
Seconde hypothèse : le donateur ne réside pas fiscalement en France. Deux cas peuvent alors se présenter :
• Lorsque le donataire est lui-même résident fiscal français au jour de la transmission (et l’a été pendant au moins 6 ans au cours des 10 dernières années), tous les biens transmis, français ou étrangers, supportent l’impôt sur les donations en France. La double imposition est évitée là encore par l’imputation de l’impôt étranger sur l’impôt français.
• En revanche, lorsque le donataire est non-résident, seuls les biens français qu’il reçoit sont taxés en France.
Quelles sont les incidences des conventions fiscales ?
Ces principes de droit interne peuvent être amendés en présence d’une convention fiscale bilatérale destinée à éliminer les doubles impositions. Celle-ci peut, par exemple, retirer à la France le droit d’imposer.
Toutefois, malgré un réseau conventionnel étendu, rares sont les conventions signées par la France qui visent les droits de donation. Il en existe, en effet, à peine une dizaine. On peut citer notamment les conventions fiscales conclues avec l’Allemagne, les Etats-Unis ou l’Italie.
Le récépissé de renouvellement d’un titre de séjour autorise t-il à travailler ?
Aujourd’hui il existe deux procédures différentes pour une demande de renouvellement. Le téléservice et la demande hors téléservice. La procédure dépendra du titre de séjour faisant l’objet de la demande de renouvellement.
En cas de demande de renouvellement par téléservice, si l’instruction se poursuit au-delà de la date de validité du titre de séjour, le préfet doit mettre à disposition du demandeur, par le biais du téléservice, une attestation de prolongation d’instruction d’une durée maximum de trois mois. Si le titre de séjour d’origine autorise l’étranger à travailler, cette attestation de prolongation permettra aussi à son titulaire à exercer une activité professionnelle. L’attestation sera renouvelée tant que le préfet n’a pas statuer. (Article R. 431-15-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA))
Lorsque la demande est faite hors téléservice, la préfecture doit normalement remettre un récépissé à l’étranger. L’article R431-15 du CESEDA prévoit que ce document autorise l’exercice d’une activité professionnelle si la carte de séjour permettait déjà de travailler. Le récépissé est délivré pour une durée de trois mois et sa validité débute à compter du lendemain de la date de validité du titre à renouveler.
À noter que même sans récépissé de renouvellement, lorsque l’étranger est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale, il pourra continuer à séjourner en France et continuer de travailler pendant trois mois après la date d’expiration de son titre de séjour. (Article L433-3 CESEDA)
Quel est le délai de prescription des cotisations de retraites complémentaires ?
En matière de cotisations de sécurité sociale, la prescription est de trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues (article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale). Ce délai de prescription n’est toutefois pas applicable aux cotisations de retraite complémentaire.
Lorsqu’une institution de retraite complémentaire souhaite agir en recouvrement de cotisations à l’encontre d’un employeur, la prescription à retenir est celle de l’article 2224 du Code civil. Conformément à ce texte, le délai est de cinq ans.
Le point de départ se situe au jour où l’institution a eu en sa possession tous les éléments nécessaires au calcul des cotisations (Dictionnaire permanent Social, Ètude AGIRC – ARRCO, Éditions Législatives).
Cependant, la Haute juridiction estime que le délai court à compter de la date d’exigibilité des cotisations (Cass. soc., 18 mars 1993, n° 90-21.575). Les cotisations calculées tous les mois, sont exigibles dès le premier jour du mois civil suivant et celles calculées tous les trimestres, dès le premier jour du trimestre civil suivant (Mémento Social 2021, Éditions Francis Lefebvre).
Un CDD de remplacement peut-il être d’une durée inférieure à l’absence du salarié remplacé ?
L’article L1242-2 du Code du travail dispose qu’un CDD peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, comme le remplacement d'un salarié en cas d’absence.
D’autres articles du Code du travail permettent des aménagements de la durée du CDD de remplacement, en effet l’article L1242-9 précise que le CDD peut prendre effet avant l'absence de la personne à remplacer et l’article L1243-7 précise que le terme du CDD peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où la personne remplacée reprend son emploi.
Aucune disposition n’interdit la conclusion d’un CDD d’une durée plus courte que celle du salarié remplacé. Ce point est d’ailleurs repris la circulaire DRT 90-18 du 30 octobre 1990 qui indique que « aucune disposition légale n'interdit à l'employeur qui conclut un contrat de date à date pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu de fixer le terme à une date antérieure à la date prévue pour le retour du salarié absent ». La Cour de Cassation s’est également prononcée en ce sens dans un arrêt du 26 février 1991 (n° 87-40.410 P).
Il conviendrait toutefois d’être vigilant sur l’application des règles de succession de contrat dans une telle hypothèse. En effet la succession de CDD de remplacements sur le même poste avec le même salarié n'est possible sans avoir à respecter de délai de tiers-temps qu'en cas de nouvelle absence du salarié remplacé. Or dans le cas présenté il ne s’agirait pas d’une « nouvelle » absence, la durée de cette dernière étant connue dès l’origine.
Peut-on cumuler un mandat social avec un contrat de travail au sein de la même association ?
Le cumul des fonctions de dirigeant et de salarié est interdit pour certaines associations notamment pour les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.
Par ailleurs, les statuts de l’association peuvent interdire ce cumul.
Hormis ces cas, il n’existe pas d’interdiction de principe (Répertoire de droit des sociétés - Rubrique Association, Dalloz). Pour que le cumul soit admis, l’existence d’un réel contrat de travail doit cependant être établie. Cela suppose des fonctions distinctes de celles du mandat social, une rémunération distincte de celle éventuellement perçue dans le cadre du mandat associatif et un réel lien de subordination.
Il convient toutefois de rester prudent car l’association pourrait encourir un risque fiscal dans la mesure où le caractère désintéressé de l’association, qui conditionne l’exonération des impôts commerciaux, nécessite une gestion bénévole de l’entité.
La jurisprudence ne semble pas définitivement fixée. Le Conseil d'État a jugé que le seul fait que le dirigeant soit rémunéré entraîne l'assujettissement aux impôts commerciaux, peu important la nature des fonctions rémunérées (CE 28-4-1986 n° 41125 : RJF 6/86 n° 579). Dans des décisions postérieures, des juges du fond ont adopté une position plus libérale admettant la séparation des fonctions de dirigeant et de salarié (CAA Paris 27-2-1996 n° 94-847 ; TA Clermont-Ferrand 5-11-1997 n° 96-464).
Que faire lorsqu’on envisage des travaux aux abords d’un monument historique ?
En droit de l’urbanisme, des règles spécifiques ont vocation à s’appliquer aux constructions situées aux abords d’un monument historique, c’est-à-dire un monument ayant un intérêt historique, qu’il soit meuble ou immeuble. Par conséquent, le classement ou l’inscription d’un immeuble en tant que monument historique va induire la création d’un périmètre de protection autour de celui-ci : les abords.
Le périmètre de protection peut être délimité par une autorité administrative, et ainsi être strictement délimité suite au concours de l’ABF et de l’autorité compétente en matière de document d’urbanisme. Dans l’hypothèse où ce n’est pas l’ABF qui détermine le périmètre de protection, il devra toutefois être consulté et donner son accord.
Cependant, il peut ne pas y avoir de périmètre délimité et dans cette hypothèse c’est un rayon de 500 mètres autour du monument historique qui constituera la zone de protection. Dans cette dernière hypothèse, pour qu’un bien soit considéré comme étant dans la bande des 500 mètres, celui-ci devra être visible soit depuis le monument protégé, soit en covisibilité de l’immeuble et du monument observés depuis un endroit situé à l’extérieur de celui-ci. Ainsi, la covisibilité peut être observée depuis tout emplacement normalement accessible au public, quand bien même la covisibilité s’apprécie en dehors des 500 mètres. L’appréciation du champ de visibilité du monument historique relève toutefois de la compétence de l’architecte des bâtiments de France (ABF).
De même, pour tous les immeubles se situant dans les abords du monument historique et soumis à une autorisation d’urbanisme, l’ABF devra être consulté afin de donner son accord. Il devra également donner son accord quand bien même les travaux envisagés ne sont pas soumis à une autorisation d’urbanisme. Par conséquent, l’ABF jouera un rôle clé dans la délivrance des autorisations d’urbanisme dès que le bien se situe aux abords d’un monument historique. Le plus souvent, les contraintes seront d’ordre esthétiques et les immeubles se situant dans ces zones disposeront de peu de marge de manœuvre pour la réalisation de leurs travaux.
Un contrat d’apprentissage peut-il être à temps partiel ?
En ce qui concerne la durée de travail de l’apprenti, le code du travail précise que le temps de formation est compris dans l’horaire de travail et que l'apprenti accomplit le travail qui lui est confié par l'employeur dans la limite de l’horaire de travail applicable dans l’entreprise (C. trav. L. 6222-24).
Il est donc soumis à la durée du travail applicable dans l’entreprise et il peut être amené à effectuer des heures supplémentaires (qui devront être rémunérées, cf Cass. soc. 11-7-2000 n° 98-41.825).
L’apprenti n’est pas un salarié comme un autre et sa présence en entreprise est avant tout liée à sa formation. Réduire la durée de travail d’un apprenti revient à amputer une partie de son temps de formation pratique en entreprise. La réalisation d’un contrat d’apprentissage sur la base d’un temps partiel semble donc inenvisageable.
L’impossibilité d’exécuter un contrat d’apprentissage à temps partiel a été repris par le ministère du travail qui spécifie dans son « Précis de l’apprentissage » en date de septembre 2021 que « par principe, le contrat d’apprentissage est conclu et exécuté à temps complet. Seules deux catégories de bénéficiaires peuvent éventuellement le conclure dans le cadre d’un temps incomplet de formation : les bénéficiaires d’une RQTH et les sportifs de haut-niveau. ». Ces deux catégories bénéficient en effet de dispositions particulières justifiant l’aménagement d’un temps de travail (C. trav. R. 6222-49-1 et L. 6222-40).
Est également évoquée la possibilité d’effectuer son apprentissage en temps partiel « si l’entreprise fonctionne globalement sur une quotité inférieure au temps complet (par exemple, un salon de coiffure ouvert seulement quatre jours par semaine) ».
Un expert-comptable peut-il exercer d’autres activités ?
Selon l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable (article 22), "L'activité « d'expertise comptable » est incompatible avec toute occupation ou tout acte de nature à porter atteinte à l'indépendance de la personne qui l'exerce, en particulier : (...)"
Avec toute activité commerciale ou acte d'intermédiaire autre que ceux que comporte l'exercice de la profession, sauf s'il est réalisé à titre accessoire et n'est pas de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des associés experts-comptables ainsi que le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie. (...)"
Selon le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable (articles 144, 145 et 146), les experts-comptables "s'abstiennent, même en dehors de l'exercice de leur profession, de tout acte ou manœuvre de nature à déconsidérer celle-ci" ; ils doivent s'attacher "à ne jamais se placer dans une situation qui puisse diminuer leur libre arbitre ou faire obstacle à l'accomplissement de tous leurs devoirs", "à ne jamais se trouver en situation de conflit d'intérêts" ; ils "évitent toute situation qui pourrait faire présumer d'un manque d'indépendance", ils "doivent être libres de tout lien extérieur d'ordre personnel, professionnel ou financier qui pourrait être interprété comme constituant une entrave à leur intégrité ou à leur objectivité".
Une association étrangère peut-elle saisir la juridiction civile française ?
La jurisprudence considère que toute personne morale « quelle que soit sa nationalité, a droit au respect de ses biens et à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial » (Cass. com. 8 juillet 2003, n° 00-21.591).
Concernant plus spécifiquement les associations, les articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 énoncent que celles-ci, françaises ou étrangères, disposent de la capacité juridique, et donc de la possibilité d’agir en justice, dès lors où elles ont été rendues publiques par le biais d’une déclaration préalable régulièrement faite en préfecture.
Au visa de cet article, la Cour de cassation refusait de reconnaître de plein droit la possibilité pour une association étrangère d’agir devant la juridiction civile et considérait comme irrecevable l’action de ces associations, même antérieurement dotées de la personnalité morale dans leurs pays d’origine, si elles ne satisfaisaient pas à l’exigence de déclaration préalable posée à l’article 5 précité (Cass. com. 3 mars 2004, n° 01-11.943).
La France s’est cependant vue sanctionnée par la Cour européenne des Droits de l’Homme au visa de l’article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme pour avoir refusé la recevabilité de la constitution de partie civile d’une association étrangère non déclarée (CEDH 15 janvier 2009, Ligue du Monde Islamique et Organisation Islamique Mondiale du Secours Islamique c/France, Bull. Joly 2009. 481, § 95, note P. Rubellin ; D. 2009. 374).
La Cour de cassation a ainsi ultérieurement reconnu que toute personne morale qui se dit victime d'une infraction peut se constituer partie civile, même si elle n'a pas d'établissement en France et n'a pas fait de déclaration préalable à la préfecture (Cass. Crim. 8 décembre 2009, n° 09-81.607).
Elle ajoute enfin que l’association étrangère doit être personnifiée et que son représentant doit avoir le pouvoir d’agir en son nom conformément au droit national dont elle relève (Cass. Crim. 1er décembre 2015, n° 14-80.394).